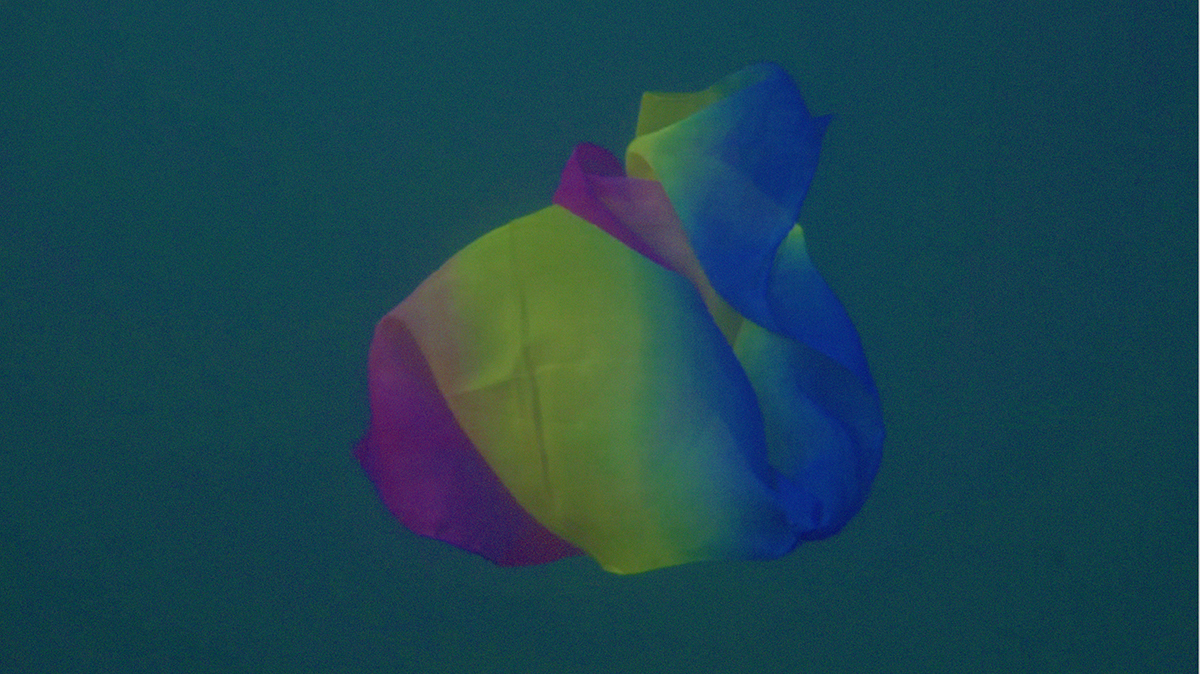Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Le Cercle de confusion, 1997. Tirage photographique découpé en 3 000 fragments tamponnés, numérotés et collées sur miroir. © Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. Galerie In Situ — fabienne leclerc.
OKWUI ENWEZOR : Commençons notre entretien par l’exploration de la constellation, de la carte de votre carrière, en allant du formel au conceptuel et au philosophique. Pour décrire votre pratique dans les grandes lignes, on pourrait dire qu’elle est une méditation sur le statut et la nature des images, sur la façon dont les images circulent dans le monde, et sur la façon dont elles s’infiltrent et s’incrustent dans nos consciences historiques.
Je souhaiterais cependant vous poser tout d’abord une question se rapportant non aux images, mais à votre méthodologie. Ce qui m’intéresse tout particulièrement ici, c’est le concept de la coupe, de l’incision que vous pratiquez dans une image, à la fois pour la dégager, la libérer du cadre et pour la recontextualiser en tant qu’objet. Vous êtes cinéastes. Pour être en mesure de regarder une image, vous coupez dans l’image. Comment se situe votre pratique par rapport à ce concept de coupe ? Ce dispositif est-il une clé nous permettant de comprendre votre travail ?
KHALIL JOREIGE : Pour moi, l’idée de coupe vient de l’idée d’un continuum – dans lequel on couperait, dont on prélèverait un fragment. Quand on réalise un film, par exemple, après le tournage il est nécessaire de réarticuler l’ensemble par le montage, en supprimant certaines parties des plans filmés, en rajoutant un effet. De sorte que, lorsqu’on parle de coupe, il s’agit de la relation du fragment au tout. Elle peut en même temps faire référence à la continuité tout en la concentrant, incarner des réalités et simultanément exprimer d’autres potentialités.
JOANA HADJITHOMAS : Dans le cas de l’une de nos premières œuvres, Le Cercle de confusion (1997), nous avons concrètement découpé une image en trois mille fragments. L’image, ce n’est pas le fragment, mais le tout. Les gens prennent un fragment, comme l’a dit Khalil, un fragment prélevé dans l’image en tant que tout, de sorte que le fragment devient abstrait et ne représente quelque chose que pour la personne qui l’a pris.
La relation à l’image en tant que tout, c’est d’une certaine manière ce que nous ne cessons de questionner. Si l’on pense qu’il est possible de définir un lieu, qu’on peut en avoir une image complète, on supprime alors la complexité de la façon dont les choses sont fragmentées. Les différentes notions de représentation se superposent les unes aux autres. Elles sont d’une grande complexité. Dans la coupe, au contraire, il y a l’idée d’un moment parfait où arrêter quelque chose et, en même temps, il y a tout ce qui est hors champ, hors de vue, ce qu’on enlève de la scène.
ENWEZOR : Comment réunissez-vous ces deux tropes, le fragment et le tout, au-delà de l’idée de couper dans l’image et, dans un certain sens, de localiser le symptôme ? Une coupe, n’est-ce pas vraiment comme une tentative de localiser le symptôme, presque comme une biopsie de l’image ? Qu’est-ce qui vous attire vers telle ou telle image, vers tel fragment, vers tel objet, au point de vouloir en faire la biopsie ?
JOREIGE : Pour en revenir à nos débuts, il faut préciser qu’aucun de nous deux n’a fait des études d’art ou de cinéma, mais des études littéraires. Nous avons commencé à prendre conscience de notre pratique grâce au fait que nous faisions des quantités de prises de vues dans Beyrouth à la fin des guerres civiles. Ici, la notion de rupture, de coupe, est essentielle, car nous avions le sentiment que c’était la fin de quelque chose. La fin des règles, peut-être. On pouvait même retrouver cette rupture dans les procédés de représentation. Cela explique pourquoi, dans nos images, nous ne représentions pas la violence. Ce qui nous intéressait, c’était de savoir comment la représentation était affectée par la réalité. Cette situation avait une incidence sur notre utilisation des images, sur notre utilisation de la narration, sur notre utilisation d’un personnage ou de notre singularité. Ici, la rupture consiste en une certaine façon de traiter les images traditionnelles. D’un côté, la tradition ; de l’autre, la coupe dans cette tradition, parfois même une coupe franche, voire un faux raccord.
Prenez par exemple un immeuble d’habitation. Un immeuble frappé par un obus n’est plus un immeuble. Il a été transformé en autre chose. Au point qu’on ne sait plus parfois où est le toit, où est la droite, la gauche. C’est un fragment dont on peut tourner l’image dans tous les sens. « La forme d’une forme qui n’a pas de forme », comme le dirait Mahmoud Darwich. Cette relation à la rupture, à la tradition, pourrait nous inciter à réfléchir à notre pratique depuis le début. Au Liban, on entend souvent dire qu’il y a un problème de mémoire. En fait, il y a plein de souvenirs, de documents, d’images, venant de l’intérieur ou résultant de l’attention régionale et internationale – les gens font beaucoup d’images.
ENWEZOR : Presque comme si la guerre civile avait fait voler en éclats le barrage de la mémoire.
HADJITHOMAS : Précisément. Khalil et moi, nous n’avons jamais pensé que le problème était ici la mémoire. Nous sommes au contraire convaincus qu’il y a trop d’images, trop de souvenirs. Nous sommes environnés d’une si grande quantité d’images. Il y a aussi, peut-être, une difficulté, qui est d’écrire l’histoire, mais cela n’a rien à voir avec la mémoire. La mémoire est présente.
JOREIGE : Dans toute notre pratique, la relation entre fiction et documentaire ne cesse d’évoluer. L’image peut être par moments une fiction, par moments documentaire, avant de changer de nouveau de statut. Cette relation questionne la manière dont nous pouvons nous réapproprier certaines images, certaines réalités, pour percevoir que non seulement elles nous concernent, mais aussi qu’elles nous parlent, qu’elles nous émeuvent.
HADJITHOMAS : Nous avons toujours cherché à rendre cette complexité, tout en lui apportant une dimension poétique. Parce que nous sommes cinéastes, l’idée de narration a toujours été importante dans notre travail, même si ce n’est pas une histoire avec un début et une fin – un instant de fictionnalisation dans l’œuvre, où le poétique participe à la narration du récit. Avec cela vient l’idée de créer notre propre récit, en laissant de la place aux autres pour qu’ils puissent se projeter avec leurs propres narrations, tout en questionnant ce qu’ils sont en train de faire. Cette idée du collectif et de l’individuel était elle aussi très importante.
ENWEZOR : J’aimerais creuser un peu plus la question de la narration. Certaines des découvertes ou inventions importantes intervenues dans l’art contemporain, disons du milieu à la fin des années 1990, sont le fait de toute une génération d’artistes originaires de Beyrouth, qui ont entrepris d’utiliser des fragments de la guerre civile libanaise, comme si l’on utilisait les ruines de la ville pour recréer et réinventer les expériences sociales communes du pays à mesure qu’il se reconstruisait. Ces artistes ont dû réinventer la stabilité même de la narration ainsi que la façon dont on pouvait utiliser la narration. Comme si toute la scène artistique s’occupait de forger les possibilités d’existence de ces narrations, leurs conditions d’évolution. Pourriez-vous évoquer avec nous cette question de la narration dans ce contexte, ainsi que ce que vous en avez produit.
HADJITHOMAS : Il était clair, dès le début, que nous ne ferions jamais certaines choses. Nous n’allions pas mettre la guerre du Liban entre parenthèses ; nous n’allions pas nous poser en victimes ni considérer l’histoire du Liban comme un moment traumatique. Ce qui nous intéresse surtout, c’est le présent, et nous ne voulons pas regarder le passé avec nostalgie. Nous voulons au contraire reprendre certaines images du passé pour les réactiver dans le présent. C’est ce que nous avons fait avec les cartes postales de Beyrouth quand nous les avons brûlées, ou avec le projet concernant la Lebanese Rocket Society. Même si c’est un retour vers le passé, c’est une autre forme de projection du passé vers l’avant, qui permet de le repenser.
Nos narrations comportent également toujours un aspect performatif. Nous aimons provoquer des choses dans le présent. Par exemple, transporter des fusées dans les rues de Beyrouth pour voir ce qui peut se passer. Ou amener Catherine Deneuve dans le sud du pays et voir quel pourrait être le rapport à la fiction face à la réalité d’un lieu après une guerre atroce. Nos narrations ne sont jamais linéaires, ni achevées, ni contrôlées. Nous savons où nous n’allons pas. Nous pouvons décider d’aller dans telle direction, mais ensuite, même si nous concevons des dispositifs très stricts, des choses peuvent arriver. Nous assistons à certaines d’entre elles et nous les suivons. Voilà notre conception de la narration.
JOREIGE : C’est une situation spécifique qui en est à l’origine : cette relation très problématique à l’histoire, à l’écriture de l’histoire au Liban. Comme le dit Joana, nous nous focalisions véritablement sur la difficulté de vivre dans le présent ; nous étions en fait enlisés dans le présent. Dans la plupart de nos films – A Perfect Day (2005), Cendres (2003), Khiam (2000), Je veux voir (2008), Open the Door, Please (2006), Rondes (2001) –, les personnages se trouvent enlisés dans le pur présent, luttant entre un passé qui les hante et l’impossibilité de se projeter vers l’avenir – ils incarnent de simples fragments d’une continuité. Cela s’explique probablement par la situation spécifique du Liban. Nous réagissons aux situations, à ce qui se passe autour de nous.

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Khiam, 2000-2007. 2 vidéos, couleur, son, durée : 103 min © Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. Galerie In Situ — fabienne leclerc.
ENWEZOR : Le mot latence qualifie de façon très significative votre travail. Ce qui le rend fascinant, c’est la façon avec laquelle il résume par des principes formels, limpides et compréhensibles la complexité d’une idée. Dans le contexte des images latentes, il y a une dimension performative, mais aussi une dimension archivistique, une dimension narrative, sans oublier la dimension énonciative du récit. Avec ce concept de latence, vous théorisez, semble-t-il, quelque chose de très puissant. Pourriez-vous nous en dire davantage sur la latence et comment elle surgit dans votre travail ?
HADJITHOMAS : Nous essayons de ne pas nous contenter de produire des images, nous questionnons inlassablement le médium image. Pourquoi ajouter d’autres images à l’actuel flux d’images ? Les images que nous produisons interrogent la présence des images de manière plus générale.
On définit la latence comme l’état de ce qui existe sous une forme non apparente, mais qui est susceptible de se manifester à n’importe quel moment. L’image latente, c’est l’image invisible qui doit-encore-être-développée sur une surface impressionnée. Nous ne cessons d’avoir l’impression au Liban de vivre dans une époque pleine de traces, traces de violence, traces de destruction, traces d’histoire. Toutes ces traces sont présentes, sans être visibles. La latence est par conséquent apparue parce que nous partagions cette impression politique que beaucoup de choses étaient latentes, qu’elles n’étaient pas discutées, mais aussi parce qu’il nous intéressait de savoir ce qui se passerait si nous retirions du flux certaines de nos images, et comment redonner du pouvoir aux images à une époque où elles sont produites en masse. Le concept de latence était un moyen de questionner notre pratique de cinéastes et d’artistes.

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Images Latentes, 3e partie du projet Wonder Beirut, 1997-2006. 3 épreuves chromogènes sous Diasec mat montées sur châssis aluminium et 38 épreuves numériques plastifiées montées sur aluminium. © Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. Galerie In Situ — fabienne leclerc.
Notre travail sur la latence a débuté d’une manière organique. Il nous est arrivé de ne pas développer nos photos en argentique pendant un certain temps, puis il nous est venu, peu à peu, l’idée que cela pouvait constituer un principe de travail très intéressant. Nous l’avons alors adopté et nous nous y sommes tenus très strictement. C’est comme cela qu’a commencé le projet Images latentes : journal d’un photographe (1997-2006). Nous avons fait des prises de vues sans les développer durant dix ans, de 1997 à 2006. C’était devenu pour nous une véritable question : que se rappelle-t-on d’une photo, qu’évoque une image si on en lit simplement la description, à quel moment et pourquoi devrait-on la développer ?
JOREIGE : Une autre origine du concept de latence, à mon avis, c’est le problème des personnes kidnappées au Liban. Plus de dix-sept mille personnes ont disparu, parmi lesquelles mon oncle. Nous étions très proches, nous habitions le même immeuble et, très soudainement, vous vous trouvez en face d’une absence présente. Pas de quelqu’un qui serait mort, mais disparu, dont on n’a aucune nouvelle ; il est présent sans être visible. Ou bien il n’est pas là, mais vous sentez qu’il est là. C’est un état très bizarre, entre plusieurs états. De sorte que la latence, pour nous, c’est véritablement un état, quelque chose qui est là, mais dont les conditions de visibilité ne sont pas présentes. Quelles peuvent alors être les conditions de la réapparition d’une image, de la réapparition d’une personne, de la révélation d’une situation ?
ENWEZOR : L’un des thèmes-clés de votre travail, c’est la question des conditions nécessaires à la vision. Votre film Je veux voir, par exemple, ne pose pas la question de ce que l’on voit, mais des conditions dans lesquelles une image peut soit apparaître, soit corroborer des situations contradictoires. Quelles conditions établissez-vous comme principes essentiels, nécessaires au développement de la rencontre ?
HADJITHOMAS : Nous avons réalisé Je veux voir en réaction à des images qui étaient montrées pendant la guerre de 2006, des images insoutenables de mort et de ruine, que tout le monde pouvait voir, mais qui n’ont pas eu le moindre effet quant aux hostilités. Nous voulions par conséquent provoquer une véritable rupture, une coupure. En mettant de façon très provocatrice un corps de fiction, de cinéma, représenté ici par l’actrice Catherine Deneuve, dans des lieux où la fiction n’est pas présente, où la réalité pèse de tout son poids ; nous avons essayé de voir si cela pouvait provoquer une réaction, au sens chimique du terme, si cela pouvait produire une autre façon de voir. Nous avons créé un dispositif très clair qui se prêtait aux expérimentations.
JOREIGE : On imagine un dispositif – les conditions nécessaires pour qu’il se passe quelque chose. Mais rien ne se produit jamais là où on l’attendait. Et si cela arrive à l’endroit prévu, alors cela aurait été un programme. Mais ce n’est jamais un programme. La surprise est une nécessité, il est nécessaire de se mettre en danger. C’est très précisément la raison pour laquelle nous ne communiquons jamais le scénario à nos acteurs. Nous l’écrivons, le reste de l’équipe en a connaissance, mais nous voulons être surpris par quelque chose d’inattendu. Comme dans une conversation. Vous savez certaines choses, je sais certaines choses, mais la conversation s’oriente dans une autre direction.
HADJITHOMAS : Et, parfois, il y a une rencontre. Si nous savions très exactement où nous allons, il n’y aurait pas de rencontre. La rencontre explique la création d’un dispositif, mais il faut accepter de ne pas savoir exactement où l’on va.
JOREIGE : Ce n’est ni vous, ni nous, c’est quelque chose d’autre. Ce peut être un lieu neutre, au sens que Roland Barthes aurait donné à ce mot, ni vous, ni nous, ni moi, ni elle, mais c’est un lieu vivant. Un lieu où l’on perçoit toutes les possibilités, toutes les promesses, où il nous est donné la possibilité de construire…
HADJITHOMAS : … des narrations.
JOREIGE : Des fictions.
ENWEZOR : Une chose me frappe depuis toujours à propos de votre travail : ses objectifs sont toujours limpides. Il montre la volonté de faire comprendre le but de l’œuvre, même si, en même temps, il y a la tentation de lui refuser une réalisation complète. Comme une sorte d’ajournement, pourrait-on dire, de la conclusion. Telle est bien votre intention ?
JOREIGE : Nous nous considérons nous-mêmes comme des chercheurs. Nous estimons que nous ne savons pas véritablement. Par conséquent, nous cherchons. Mais, quand nous commençons à avoir des réponses, cela implique habituellement que nous devons couper, pour passer à un autre projet. En regardant notre pratique, on constate qu’elle fonctionne par projets, et chaque projet peut prendre de nombreuses formes différentes. Dès lors que nous commençons à maîtriser tel ou tel lieu, cela devient dangereux, car nous risquons de produire des répétitions, alors nous le quittons. C’est pourquoi ce qui nous intéresse, peut-être, ce sont les lieux de doute.

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, 180 secondes d’images rémanentes (détail), 2006. 4 500 photogrammes, tirages lambda sur papier, bois, bandes velcro. © Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. Galerie In Situ — fabienne leclerc.
HADJITHOMAS : J’utiliserais le terme de fragilité. Nous sommes convaincus qu’une œuvre d’art doit avoir une fragilité essentielle. Qu’il ne faut pas être obsédé par l’efficacité ou la maîtrise. Cette fragilité nous intéresse beaucoup du point de vue de la forme. Lorsque nous avons réalisé 180 secondes d’images rémanentes (2006), par exemple, une œuvre de grand format composée de photogrammes inspirés d’un film tourné par l’oncle de Khalil avant son enlèvement, film que nous avons trouvé sous sa forme latente trente ans plus tard, nous avons eu le sentiment de la grande fragilité des conditions propices à la réapparition de cette image. L’œuvre doit par conséquent restituer cette impression. Les images sont alors scannées, tirées, coupées et collées d’une façon telle que nous avons à tout instant le sentiment que l’œuvre risque de se défaire ou de tomber, de disparaître. Nous estimons qu’il est essentiel de conserver cette idée. En particulier parce que ces œuvres sont vues dans le monde de l’art, qui est aussi un marché et qui véhicule également l’idée de possession. Or, l’œuvre d’art, par sa fragilité, doit être capable de s’échapper. Il est essentiel de conserver cette poétique. Il en va de même pour nos films. Quand nous réalisons nos films, nous ménageons dans la narration un espace ouvert, c’est-à-dire une fragilité. Nous y tenons absolument. Pour ne pas être systématiquement efficaces.
ENWEZOR : Ce qui nous amène au fait que, comme Khalil l’a mentionné, vous travaillez un projet après l’autre. Comment décidez-vous du support de votre prochain projet ? Sera-t-il une conférence-performance, un livre, un film, une installation ? Qu’est-ce qui oriente la prise de décision finale ?
JOREIGE : Notre travail fonctionne sous forme de groupes d’œuvres ou de projets : par exemple, Archéologie de notre regard (1997), le projet Wonder Beirut (1997-2006), les films et installations sur Khiam, le projet The Lebanese Rocket Society (2011-2013), et plus récemment les ensembles d’œuvres traitant des arnaques Internet, les scams, et, enfin, de poésie… Ce n’est pas intentionnel. Nous nous lançons habituellement dans de longues recherches, nous explorons les aspects thématiques, formels et historiques, et, selon le matériel que nous rencontrons, les choses évoluent. Par exemple, pour le film intitulé ISMYRNE (2016), nous avions imaginé une installation vidéo, mais, en raison du matériel que nous avons rencontré, c’est devenu un film. Nous devons respecter la rencontre. La rencontre vous emmène d’un lieu à l’autre, et vous évoluez avec elle. Vous cherchez, vous vous questionnez, vous questionnez votre propre pratique. Il y a aussi un aspect performatif qui vous incitera à construire une nouvelle narration, laquelle vous conduira à une certaine forme.
HADJITHOMAS : Comme dans notre conférence-performance Aïda, sauve-moi (2009), un événement intervenu durant la projection de notre long métrage A Perfect Day nous a amenés à réévaluer en profondeur notre relation aux images, à la fiction et aux documents, ou même comme dans le projet que nous avons réalisé pour la Biennale de Venise, une installation artistique devenant un livre, devenant une performance, devenant une nouvelle œuvre. Ce n’est jamais planifié. C’est une série de rencontres. Un mélange de différents médiums, un mélange de pratiques.
JOREIGE : C’est un travail en mouvement.
ENWEZOR : C’est expérimental.
HADJITHOMAS : C’est très expérimental. Ça doit évoluer beaucoup. Et il faut suivre tout cela. Ce qui nous intéresse, c’est de pouvoir explorer un sujet et lui donner différentes temporalités, différentes modalités, différentes formes. C’est une sorte de liberté que nous souhaitons conserver.
JOREIGE : Tout d’un coup, nous pouvons envisager que notre recherche soit la condition de création de nouveaux dispositifs, de nouveaux lieux de négociation. Comme lorsque nous avons amené Catherine Deneuve à la frontière pour voir si nous serions capables de faire un film là-bas ou d’ouvrir une petite route, ou quand nous avons transporté une sculpture représentant une fusée dans les rues en montrant que ce n’était pas un missile, mais une fusée destinée à l’exploration spatiale. Il s’agit d’un travail de reconstitution, de remise en scène de certains événements et d’une négociation dans le cadre de certaines réalités, de trouver de nouveaux dispositifs à un moment où vous avez le sentiment que votre territoire rétrécit. Comme dans notre œuvre vidéo sur deux écrans Se souvenir de la lumière (2016), où nous avons fait des expériences avec la transformation des couleurs et nos perceptions sous l’eau. Les ruptures, les coupes, ce sont des lieux où nous voulons nous battre, où nous voulons être présents.
HADJITHOMAS : C’est une rupture parce qu’il nous est nécessaire d’évoquer l’histoire, de nous rapporter à l’histoire. Pour mieux comprendre comment nous nous situons dans ces temporalités, et comment sont situées ces temporalités elles-mêmes.
ENWEZOR : Cela relève de l’idée de la chronique. Je suis convaincu que votre œuvre est empreinte d’une dimension littéraire très forte.
HADJITHOMAS : Il est certain que nous nous considérons nous-mêmes comme des conteurs. De plus, la littérature, c’est ce que nous avons étudié ensemble. Il me semble que les choses sont plus claires aujourd’hui, parce que de nombreuses œuvres sont reliées entre elles, certains récits sont liés les uns aux autres. C’est ainsi qu’est arrivée l’idée de la chronique, de l’écriture et de la représentation de ce qu’est l’histoire, mais aussi de la construction des imaginaires.
ENWEZOR : Je souhaiterais faire un retour en arrière en guise de conclusion. Vous avez beaucoup parlé de cette rupture, ou de failles. Il y a deux simultanéités dont il convient de tenir compte dans votre travail : la faille de la mémoire et la faille de la vision. Comment ces deux aspects sont-ils conciliés ? Lorsque je considère votre travail dans son ensemble, je me demande s’il est vraiment possible de produire une pratique aussi riche, dense, complexe et presque inépuisable en un certain sens, dans un pays aussi minuscule que le Liban. En parlant de cette relation, entre la faille de la vision et la faille de la mémoire. Toutes ces ruptures deviennent visibles à mon sens. Elles sont en quelque sorte à la fois physiques et mnémoniques.
JOREIGE : La plupart du temps, nous nous efforçons de traiter une situation, une préoccupation très spécifique. Très précise. Et plus nous sommes précis et locaux, plus cela permet à certains territoires de s’étendre. Brusquement, cela fait écho dans d’autres territoires, dans d’autres dimensions, dans d’autres époques. Nous sommes convaincus qu’il existe un territoire de l’art et du cinéma, et ce territoire, c’est le lieu où nous avons la possibilité de partager des questions et des soucis d’ordre politique, esthétique et formel. C’est ce qui est intéressant pour nous, quand cela parvient à créer d’autres réseaux, à se raccorder à d’autres dimensions dans le temps et dans l’espace.
Traduit de l’anglais par Christian-Martin Diebold
Cet entretien est tiré du catalogue publié à l’occasion de l’exposition. Coédition Jeu de Paume / Sharjah Art Foundation / Haus der Kunst, Munich / IVAM, environ 500 pages et 600 illustrations, 39 €. Entretiens des artistes avec Okwui Enwezor et avec José Miguel G. Cortés et Marta Gili, textes de Hoor Al Qasimi, Philippe Azoury, Omar Berrada, Boris Groys, Brian Kuan Wood, Nat Muller et Anna Schneider.
Okwui Enwezor est directeur de la Haus der Kunst, Munich, et a été directeur artistique de la 56e édition de la Biennale de Venise en 2015. Il est le fondateur et rédacteur en chef de Nka. Journal of Contemporary African Art.
L’exposition au Jeu de Paume
La sélection de la librairie