« Ce n’est pas « le peuple » qui produit le soulèvement,
c’est le soulèvement qui produit son peuple,
en suscitant l’expérience et l’intelligence communes,
le tissu humain et le langage de la vie réelle
qui avaient disparu »
Comité Invisible, À nos amis, La Fabrique éditions, 2014.

Photos : Anna Mariani, “Favela au Sertão” (Nord-est du Brésil), 1935. Photographie à la Bibliothèque Nationale de France par Eduardo Jorge, 2016.
Malgré les mauvaises conditions géologiques, quelques formes de vie végétales se dressent de terre, faisant du paysage un lieu de fort contraste entre la puissance de la vie et l’aridité du sol. Il s’agit d’un dépaysement pour celui qui se déplace en cette région sèche et très pauvre. En quoi consisterait la pauvreté géologique d’une terre, et de ses habitants ? En remontant à la source botanique du terme “favela”, nous pouvons nous représenter toute l’histoire des soulèvements qui se transforment perpétuellement au gré de l’inconstance du sol ou de celle de ses habitants qui ont dû développer d’autres formes de vie.
D’après une note botanique d’Euclides da Cunha, parue en 1902 dans le roman Hautes Terres – la guerre de Canudos, « les favelas, encore anonymes dans les registres scientifiques – ignorées des savants, trop connues des rustres –, peut-être un futur genre cauterium des légumineuses, ont dans leurs feuilles aux stomates allongés en villosités de remarquables outils de condensation, d’absorption et de défense. Si leur épiderme se refroidit la nuit bien au-dessous de la température de l’air, et provoque, malgré la sécheresse de ce dernier, de brèves précipitations de rosée, la main qui les saisirait se heurterait pourtant à une plaque incandescente d’une chaleur intolérable. »1
Soulèvements de la terre et des peuples : la guerre de Canudos

Euclides da Cunha. Hautes Terres. La guerre de Canudos. Paris : Métailié, 2012. Trad. Jorge Coli et Antoine Seel. p. 72. Photographie à la BNF par Eduardo Jorge, 2016.
Les « favelas » ont une origine végétale. Il s’agit d’une plante qui pousse dans des conditions géologiques très difficiles. Malgré les accidents de terrain, elle croît généreusement de manière rhizomique. Le parcours de cette existence végétale nous ramène à la racine d’un soulèvement, qui fut l’objet d’un roman paru en 1902 : Hautes Terres – la guerre de Canudos.
L’auteur de ce roman, Euclides da Cunha, était parti au front de la guerre de Bahia qui opposait une communauté messianique et l’Armée de la République dans le but d’écrire une série d’articles pour un journal. Les insurgés avaient pour guide spirituel un prophète nommé Antonio Conselheiro. Avant la guerre, 25 000 personnes vivaient à Canudos. Parmi elles des agriculteurs, quelques personnes issues de l’esclavage, ou des déplacés qui avaient construit une communauté autour de ce nouveau prophète. Mais cette vie communautaire est bien vite devenue une menace pour les propriétaires de la région.
La communauté entra en conflit avec l’État suite à la non réception du bois que les habitants de Canudos avaient acheté – et payé – pour la construction d’une église. La communauté organise alors un groupe armé pour récupérer le bois auprès des commerçants. La police locale tente de les arrêter, mais échoue devant leur nombre. Suite à cet événement, la police demande l’aide de l’Armée républicaine.
Installée sur place pour combattre les rebelles, l’Armée de la République se regroupe sur une colline plantée d’habitations précaires qui formaient comme un labyrinthe nommé Favela ou Morro da Favela (Colline de Favela). Comme sur un front de guerre, les soldats ont vécu là-bas pendant le temps du conflit, entre 1896 et 1897. Une fois la guerre de Canudos terminée, la majorité des anciens combattants est retournée à Rio de Janeiro, mais seules les collines de la capitale étaient encore habitables. Pour faire face aux difficultés économiques, les ex-militaires ont reproduit le mode de vie de Canudos : la favela. Ce sont donc eux, ces militaires qui avaient participé au massacre de la communauté messianique, qui sont devenus les nouveaux « misérables ».
Cet épisode est ainsi décrit par Euclides da Cunha : « Au sud, les cimes de la Favela se fermaient devant elle, en regorgeant de blessés et de malades. Vers le nord et le levant, s’étendait le désir impénétrable. Apparemment, son champ d’action avait augmenté. Deux campements distincts semblaient jouir d’une plus grande liberté de mouvement, délivrés du cercle étouffant des tranchées. Mais cette illusion se dissipa le jour même de l’assaut. Balayés quelques heures auparavant par des charges à la baïonnette, les monts étaient de nouveau garnis de jagunços2. Les communications avec la Favela se révélaient aussitôt difficiles. Les blessés, qui s’y traînaient, étaient à nouveau touchés par les balles ; et un médecin, le Dr Tolentino – qui était descendu de la Favela dans l’après-midi –, fut atteint et grièvement blessé, sur le bord de la rivière. Les conquérants avaient toutes les peines du monde à traverser le terrain conquis. Par ailleurs, les soldats qui avaient envahi cette partie réduite du village imitaient, point par point, les jagunços qu’ils avaient observés auparavant. Comme eux, ils s’entassaient dans les masures brûlantes comme des fours, sous la réverbération des midis étouffants, et ils restaient là, immobiles, de longues heures durant, tombant dans le même travers scandaleux de la guérilla d’embuscades : ils collaient leurs faces contre les fentes des murs, scrutaient l’amas des maisons, et tiraient, tous en même temps – cent, deux cents, trois cents tirs! –, contre une silhouette ou contre un simple chiffon entrevu au loin, indistinct et furtif, dans le tourbillon des ruelles. »3
Les chiffons ou le mouvement des silhouettes contre lesquels se battaient les soldats ont été incorporés par Helio Oiticica qui en a fait le cœur de son œuvre.
Les favelas et les parangolés d’Oiticica : soulèvements de la forme et de la matière.

Parangolés de Hélio Oiticica au favela de la Mangueira (Manguier), 1965. Photo : Andreas Valentin. Photographie à la Bibliothèque Nationale de France par Eduardo Jorge, 2016.
Pour les ex-combattants qui vivaient dans les Favelas de Rio de Janeiro, la bataille fut un double échec : non seulement ils avaient perdu la guerre, mais ils s’étaient de surcroît retrouvés socialement exclus. Certains, les plus pauvres issus de l’esclavage ou des migrants sans moyens avaient trouvé dans ces bidonvilles un lieu de vie. Géologiquement, l’État de Rio de Janeiro étant très accidenté, les hommes se déployaient sur les collines à la manière de racines, comme si la vie humaine adoptait la stratégie d’une forme de vie végétale. Un rhizome humain peuplait les plateaux. L’étude de Paola Berenstein-Jacques sur l’esthétique des favelas reconstitue la manière dont les favelas poussaient dans la ville pendant la nuit :
En dépit de leurs noms d’arbres (Mangueira, Manguier) ou d’arbuste (Favela), les favelas se développent plutôt comme l’herbe qui pousse naturellement dans les terrains vagues. Les abris des favelas occupent un terrain vacant, à l’image de l’herbe qui pousse discrètement sur les bords et finit par occuper la totalité du terrain assez rapidement. L’invasion des terrains par les favelados, qui se mobilisent toujours en groupe dans un esprit communautaire, se déroule pendant la nuit ; chaque matin, plusieurs abris ont poussé sur les bords des terrains vagues pendant que la ville traditionnelle dormait. Ce type d’occupation génère une situation opposée à celle de la ville conventionnelle car dans les favelas, la périphérie des terrains occupés est plus valorisée que le centre. Les favelas sont acentriques ou, plutôt, excentriques. La périphérie, la ligne qui sépare la favela du reste de la ville, devient le centre. Et le centre n’est plus un point fixe mais une ligne qui se déplace4
Le dédale qui définit le mode d’être des favelas fut un topos de certaines expériences esthétiques qui se présentaient comme de véritables soulèvements de la forme, et qui s’ancraient dans le mode de vie des favelas. La samba fut l’une des premières expériences esthétiques de ce type. Les premières sambas produisaient en effet des sons, sortes de lamentos déclamés par les anciens esclaves qui travaillaient désormais comme vendeurs ambulants ou employés de maison. Ce lamento était entraîné par le rythme précaire des percussions et instruments à cordes. Dans la samba enregistrée en 1916, Pelo telefone [Par téléphone], on entend le lamento « ai, ai, ai », comme une sorte de « blessure à entendre ». Mais la samba bifurqua et trouva assez rapidement de nouvelles formes. En dépit de tout cela, elle restera indissociable de la forme festive la plus polyphonique du Brésil : le Carnaval.

Hélio OITICICA et Leandro KATZ, Parangolé – Encuentros de Pamplona, 1972, impression chromogène sur papier et carton. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Photo : Archives Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía / © Projeto Hélio Oiticica / © Leandro Katz.
Déjà dans les années 1970, celui qui aspirait à créer un grand labyrinthe, l’artiste Hélio Oiticica, avait trouvé dans la favela un modèle pour repenser formellement la peinture, les mouvements expressionnistes et abstraits ainsi que le constructivisme qui est à l’origine de l’art concret au Brésil. Les favelas, notamment la Mangueira (Manguier) fut le pied-à-terre de l’artiste. C’est là qu’il a reconstitué l’expérience des cultures périphériques, non seulement celles de Rio de Janeiro, mais aussi celles d’autres grandes villes comme New York et Londres. C’est dans ces bidonvilles qu’il a mis en œuvre le soulèvement de la matière, soit le « parangolé ». Le « parangolé » permet de sortir la peinture du plan bidimensionnel pour donner du mouvement à la couleur. C’était des sortes de capes portées dans un premier temps par les habitants de la favela, et mises en mouvement par le rythme de leurs corps.
Le mot « parangolé » est issu du vocabulaire argotique des favelas et peut signifier à la fois un « truc » et « qu’est-ce qui te prend ? », en portugais, Qual é o parangolé?
Par contre, Hélio Oiticica a détourné le terme de son folklore en faisant référence au terme “Merz” inventé par l’artiste Kurt Schwitters : « le terme Merz et ses dérivés (Merz-bau, etc.), qui représentait pour lui la définition d’une position expérimentale spécifique, fondamentale pour la compréhension théorique et existentielle de toute son œuvre ». C’est ainsi que, dans la favela, cet espace ni absolument rural ni authentiquement urbain, l’artiste a théorisé le terme « parangolé » : « Trouver » dans le paysage du monde urbain, rural ou autre, des éléments de Parangolé est compris ici comme l’établissement de relations « structurales-perceptibles » entre ce qui croît dans la trame structurale du Parangolé (représentant ici le caractère général de la structure-couleur) et ce qui est « trouvé » dans le monde spatial environnant. Dans l’architecture de la favela par exemple, on trouve implicitement un caractère du Parangolé, dans la structure organique de ses éléments qui associe la circulation interne et le démantèlement externe de ces constructions : il n’y a pas de passages brusques de la « chambre » au « séjour »5.
Oiticica en Dionysos
L’œuvre de Hélio Oiticica était habitée d’un esprit dionysiaque qu’il a développé dans les années 1960/70 parallèlement à Londres, à New York, et dans les favelas de Rio de Janeiro. Il s’agissait d’expériences extatiques de dépassement du corps et d’incorporation de la terre dans l’œuvre. Dans cet esprit, il a incarné un adepte de Dionysos dans le film d’Ivan Cardoso dans les années 1980, O Segredo da Múmia (Le secret de la Momie).
Un exemple de ce genre d’expérience est saisi dans la photo prise durant le tournage du film de Cardoso par l’anthropologue Eduardo Viveiros de Castro, qui se partageait à l’époque entre ses activités en Amazonie et ses aventures artistiques à Rio de Janeiro. Cette image n’est pas seulement une synthèse des expériences d’Oiticica, mais elle illustre le phénomène archaïque du mouvement des tissus mûs par le corps dans les « parangolés ». Au cœur de ce phénomène se mélangent le pathos dionysiaque et l’ethos apollinien, autrement dit, la danse et la peinture. Le mouvement de la danse (dionysiaque) et même, la marche instable dans une favela, active le support de la couleur et du tableau. La couleur devient corps. Le corps devient couleur.
Parmi toutes ces histoires de soulèvements, Hélio Oiticica s’est particulièrement engagé dans le soulèvement de la matière. Il a voulu donner du mouvement à la peinture en lui insufflant le rythme de la vie des gens des favelas, qui est non seulement marquée par la précarité, mais aussi par leur façon de soulever leur corps, le chant, la musique, la danse, et finalement la joie de vivre, positionnement qui sera déterminant pour d’autres artistes.
C’est dans cet état d’esprit que le poème « Labyrinthe » de Ricardo Aleixo incorpore tout à la fois la joie et la révolte. En se reconnaissant comme Oiticica dans l’ambiance des Favelas, le poète marche à l’aise dans une banlieue qu’il ne suffit pas de connaître par le regard. Le marcheur doit aussi la connaître avec ses pieds:
Je connais la ville
comme la plante de mon pied
Esprit et corps prêts
à éviter
d’autres humains policiers
voitures bus trous
et objets sur le trottoir
j’incorpore aujourd’hui l’Ombre demain
l’Homme in
visible vendredi soir
le dangereux Personne
et j’avance.
Comme les aveugles
je connais le labyrinthe
pour le fouler
pour l’avoir
par cœur sur la pointe des pieds
à la manière aussi de ce que
font quelques uns
avec le ballon
dans un quelconque match
pieds nus. Je connais la
ville entière (le
moindre pli droites chaque bord
coins) et là – au
péril de me
perdre – je me
reconnais.6
Dans une démarche différente, l’artiste et écrivain Nuno Ramos a également mis en œuvre un soulèvement de la matière. Développant dans les années 1980 une pratique mise au point dans l’atelier, Ramos construit une prose avec les matériaux usés qui sont le fruit de son expérience et qui s’ancrent d’abord dans sa peinture. Dans le poème en prose « goudron » l’artiste fait de la dépense un sujet qui transforme le texte en une série de sculptures éphémères :
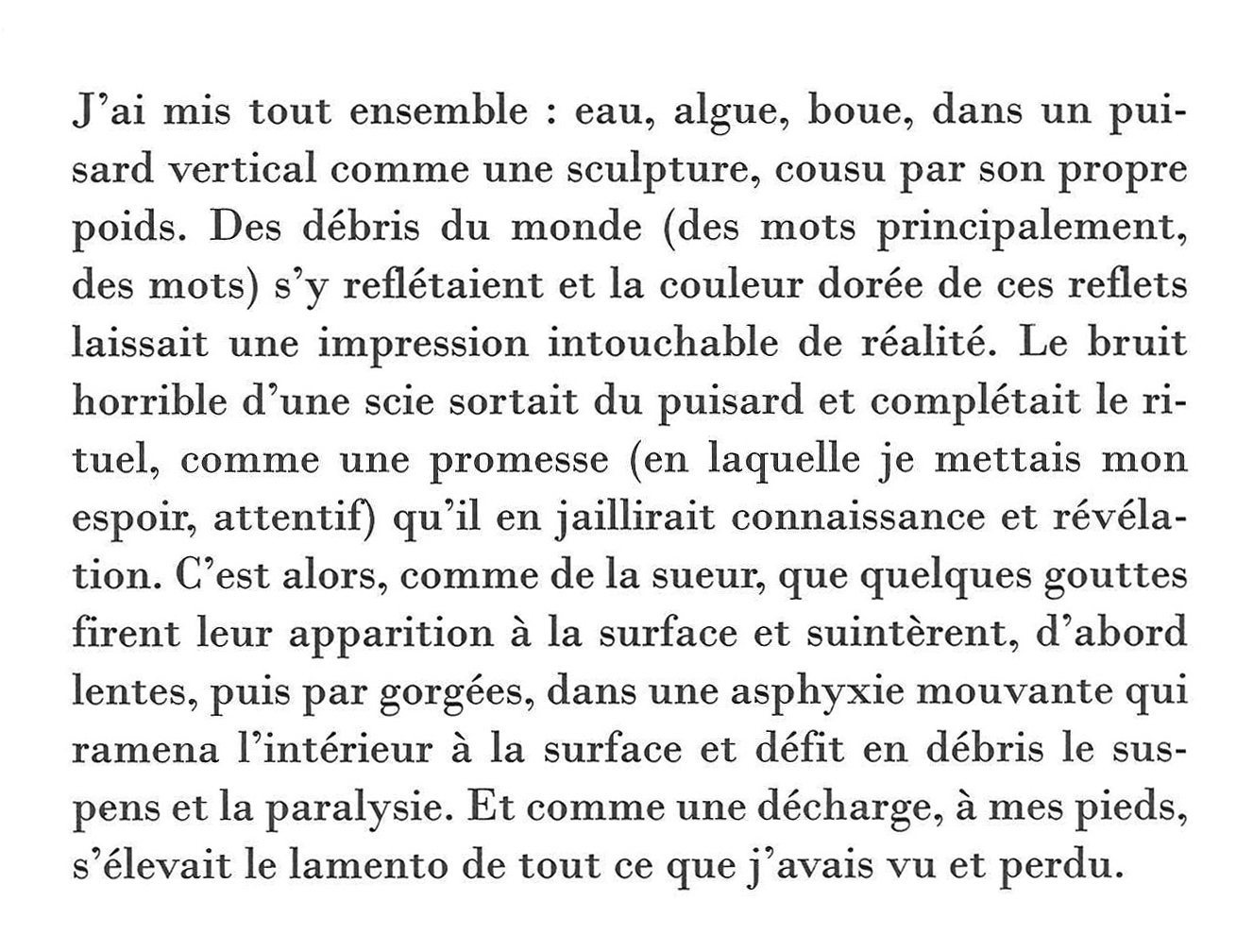
Süssekind, Flora (Dir.), Ramos, Nuno. « Goudron ». La poésie brésilienne aujourd’hui. Trad. Patrick Quillier. Bruxelles : Le Cormier, 2011, p. 139.
Finalement, dans ce bref parcours prennent forme les soulèvements de formes de vie à la fois végétales et humaines, tandis que sous les mains des artistes comme sous la plume des écrivains, la matière, la terre, les couleurs, les objets, autant organiques qu’inorganiques, se révoltent. De l’arbuste à la colline de la guerre de Canudos, en passant par la samba et les « parangolés », les favelas dressées hors de la terre ont pris un autre sens : un sens communautaire que leur ont donné ces hommes inventeurs de sentiers tels qu’Euclides da Cunha, Hélio Oiticica, Ricardo Aleixo ou Nuno Ramos. Imaginés et mis en place par ces artistes et écrivains, ces soulèvements ne sont pas à venir mais inscrits dans le présent. Sur ces sentiers se soulèvent une multiplicité de peuples muets. Et dans ce silence se tisse une diversité de peuples : « Le « peuple » n’existe pas car, même dans un tel cas d’isolement, il suppose un minimum de complexité, d’impureté que représente la composition hétérogène de ces peuples multiples et différents que sont les vivants et leurs morts, les corps et leurs esprits, ceux du clan et les autres, les mâles et les femelles, les humains et leurs dieux ou bien leurs animaux… », « Il n’y a pas un peuple : il n’y a que des peuples coexistants, non seulement d’une population à l’autre, mais encore à l’intérieur – l’intérieur social ou mental – d’une même population aussi cohérente qu’on voudrait l’imaginer, ce qui, d’ailleurs, n’est jamais le cas »7.
Eduardo Jorge
Eduardo Jorge est professeur de littérature, arts, médias à l’Université de Zurich.
Liens
“Soulèvements” : l’exposition
Blog Invité d’Eduardo Jorge et Pedro Araya – “Archives au feu, une image des cendres”
Blog invité de Beatriz Preciado – “Oiticica : Pharmacofictions”
References


