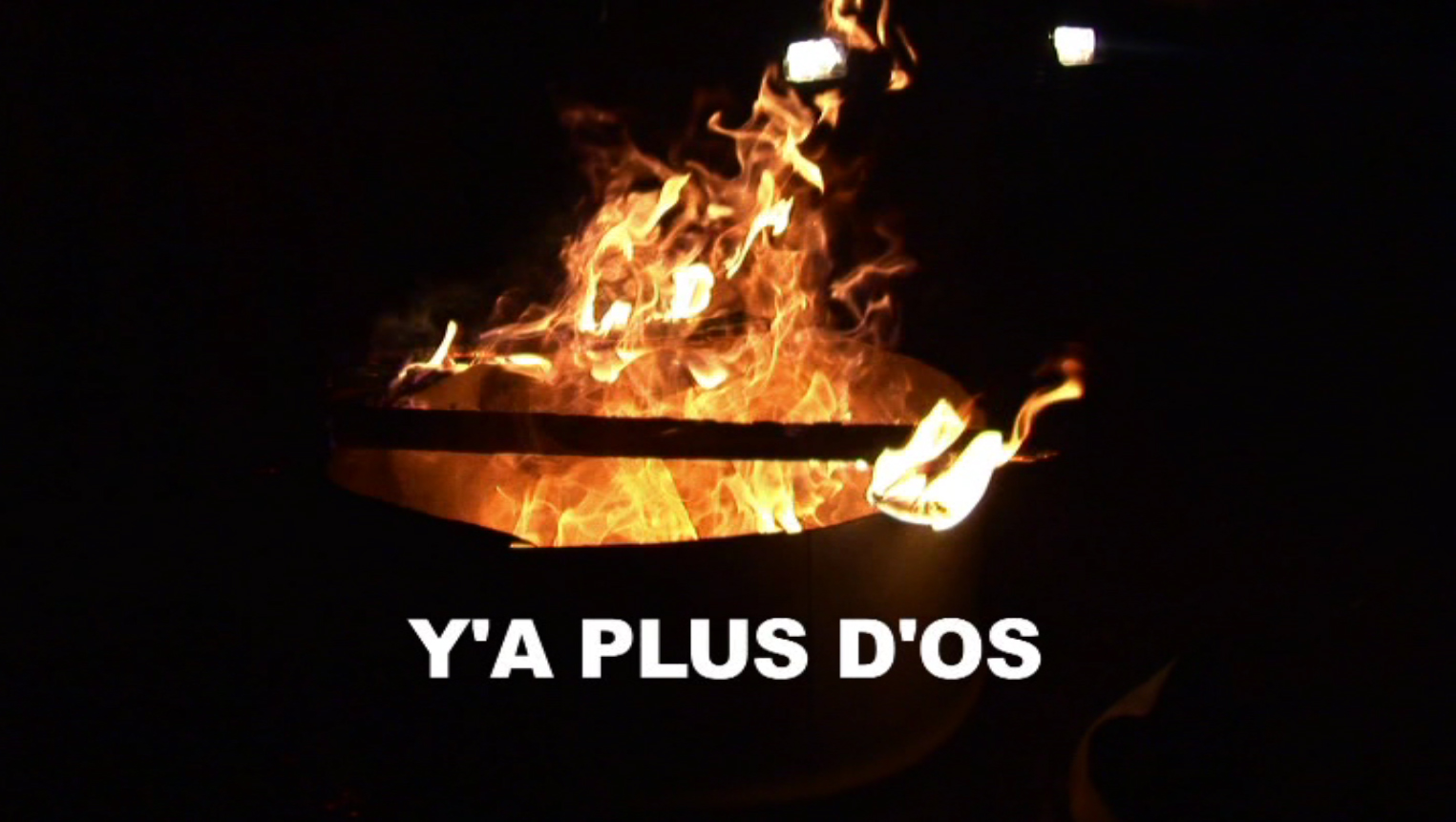Katia Schneller, Docteur en Histoire de l’art, a rencontré Marta Ponsa, responsable des projets artistiques et de l’action culturelle du Jeu de Paume et commissaire de « Faux Amis, une vidéothèque éphémère » pour le magazine.
Katia Schneller Pourquoi as-tu choisi le titre « Faux Amis » pour désigner la vidéothèque éphémère?
Marta Ponsa Étant de langue maternelle espagnole, j’ai fait l’expérience des « faux-amis » assez naturellement. Les faux-amis génèrent des traductions erronées ou décalées qui créent des malentendus ou parfois des interprétations inattendues.
J’ai choisi et utilisé ce titre comme une métaphore pour rassembler des vidéos qui traitent une réalité politique, sociale ou historique en essayant de les problématiser par l’ajout de sens alternatifs, afin d’offrir une lecture plus ouverte des événements qui nous entourent. La Vidéothèque éphémère propose donc des récits différents du monde contemporain. Il me semble que cela fait sens dans un univers globalisé et en réseau, au sein duquel les cultures se rencontrent. Pour finir sur cette question, les faux-amis sont autant d’approches concurrentes des discours dominants. Ils révèlent le caractère intrinsèquement personnel de nos approches et de nos lectures de la réalité.
Benoît Broisat, Diary, 2010 Vidéo, couleur, muet, 5’18’’ Courtesy Galerie Bugada & Cargnel, Paris © Benoît Broisat
KS Comment as-tu choisi les vidéos?
MP Mon commissariat s’est fondé sur des oeuvres qui prennent la forme de micro-récits. Je ne me suis pas donné de cadre géographique ni temporel: les pièces datent du milieu des années 1990 à aujourd’hui et les artistes proviennent d’une quinzaine de pays. Vidéos documentaires, fictions ou performances, ces films sont un miroir de la diversité des langages utilisés par les artistes pour proposer une lecture personnelle des évènements historiques. Il y avait des artistes incontournables pour moi car une grande partie de leur pratique s’intègre dans une mise en question de l’histoire officielle.
Tel est le cas de Deimantas Narkevicius qui revisite certains évènements des pays de l’ancien bloc de l’Est, notamment de son pays natal, la Lituanie, à travers des documents d’archives, des témoignages, des fictions etc. Dans ses films, il interroge le passé et le renvoie vers le présent. Dans Matrioskos, il a choisi de raconter une histoire récente, celle du trafic de personnes mais sous la forme d’une fiction inspirée de la téléréalité. Dans la même lignée, les pièces d’Arthur Zmijewski mettent en exergue la complexité psychologique des enjeux politiques et de pouvoir liés à l’histoire de son pays, la Pologne. Ses vidéos sont presque des performances qui secouent autant les acteurs que les spectateurs comme dans Notre carnet de chant où les chansons éveillent des sentiments ambivalents. La vidéo Intervista d’Anri Sala devient une clé pour parler du souvenir mais aussi de l’oubli, et nous amène à nous demander si nous avons le droit d’oublier notre histoire, notre passé.
Lorsque j’ai vu La liberté raisonnée de Cristina Lucas, il m’a paru indiscutable qu’elle devait faire partie de la sélection. La relecture de l’histoire y est bien sûr présente, mais aussi la possibilité d’interpréter le passé en soulignant la nature arbitraire de certaines évidences. Cette pièce est aussi importante, car elle introduit un langage non documentaire dans l’exposition et une esthétique différente.
Deimantas Narkevicius, Matrioškos, 2005. Video Betacam SP, 23’47’’ Courtesy de l’artiste, FNAC 07-134, Centre national des arts plastiques – ministère de la Culture et de la Communication, Paris, gb agency, Paris © Adagp, Paris, 2010
KS Les années 1970 ont marqué la fin dans le monde occidental de ce que Lyotard a appelé les « grands récits » et leur dissolution dans les microrécits. Cette rupture avec les aspirations universalistes de la modernité a été qualifiée de « postmoderne » au début des années 1980. Penses-tu que l’élargissement mondial de la scène artistique a contribué à un redéploiement de ces questions depuis les années 1990 ?
MP C’est certain que la scène artistique élargit ses frontières. Le centre de son activité est passé de l’Europe aux Etats-Unis, pour ensuite englober l’Amérique latine, l’Asie, les pays émergents, l’Europe central et de l’Est… Des biennales et des festivals s’organisent dans des lieux lointains, afin de donner une existence à ces emplacements sur la carte du monde globalisé. Je ne veux pas dire que toutes ces nouvelles rencontres ne sont utilisées que pour attirer un tourisme culturel. Au contraire, cette décentralisation culturelle nous offre la possibilité d’accéder à des histoires locales et très « spécifiques ». De par sa forme, le micro-récit me semble plus pertinent aujourd’hui que la quête d’une éventuelle universalité, qui à mon sens, n’existe pas. Je pense qu’il faut partir du local pour aller au global sans quoi le discours reste flou. Dans ce sens là, de nouvelles plateformes artistiques et curatoriales parlent du compromis de l’art pour réévaluer nos modes de vie dans le capitalisme contemporain. Ces collectifs vont utiliser le pouvoir de ces manifestations culturelles pour introduire certaines pratiques et des discours hors du mainstream et des thématiques dominantes. Tel est le cas de collectifs comme Tranzit ou What, How & for Whom (WHW). Ces derniers, ont été les commissaires de la 11ème Biennale d’Istanbul What Keeps Mankind Alive?, dans laquelle j’ai retrouvé les vidéos des Israéliennes Ruti Sela et Mayaan Amir ainsi que de l’artiste palestinienne Larissa Sansour. Beyond Guilt # 2 de Sela et Amir traite des tensions identitaires de la jeune génération israélienne, en organisant des rencontres intimistes dans des chambres d’hôtel. Sansour évoque les contradictions qui sont intrinsèques à toute identité qui se veut officielle, ainsi que l’impossibilité de se présenter sous une identité unique. Sela et Amir dirigent le projet Exterritory, une plateforme culturelle et artistique visant à développer et partager des connaissances dans des territoires autonomes et en dehors des frontières politiques. Il s’inscrit dans cet élargissement des espaces artistiques et de réflexion sur la culture contemporaine.
Ruti Sela et Maayan Amir, Beyond Guilt #2, 2004 Vidéo, couleur, son, 19’19’’ Courtesy des artistes © Ruti Sela et Maayan Amir
KS Des cultures très différentes sont en effet représentées dans l’exposition. Si chacune s’appuie sur son histoire, ses référents, ses propres crises et drames, penses-tu qu’il y ait des types ou des formes de récits qui soient récurrents ?
MP Les vidéos sélectionnées présentent certainement des contextes culturels différents. Bien que le documentaire soit une forme de récit importante, elle n’est pas exclusive. On a beaucoup parlé ces dernières années du retour du documentaire. En effet depuis la Documenta 11 en 2002 et des expositions comme « True Stories » au Witte de With de Rotterdam ou « Archive Fever » à l’ICP, New York, la présence des vidéos documentaires s’est généralisée dans les musées et centres d’art. La vidéothèque inclut des documentaires, mais il y a un nombre considérable de variations comme de points de vue artistiques.
L’œuvre de Sally Gutiérrez traite de sujets éminemment sociaux avec un langage documentaire. Elle soulève des réalités très diverses mais marginales qui vont de la solitude des personnes âgées ou du trafic d’organes à la problématique du sida en Afrique du Sud. Formellement sa vidéo Still Day Lives a un point de vue documentaire mais il est clair qu’il n’y a pas de volonté journalistique et descriptive. Benoît Broisat construit quant à lui son Journal Intime d’une manière très différente : à travers des images fixes qui circulent en rythme vertigineux, comme un diaporama en haute vitesse. Il s’agit d’un style totalement différent pour mettre en évidence le bombardement d’images auquel nous sommes soumis et leur perte de sens une fois qu’elles ne sont plus dans le feu de l’actualité. Formellement très différente, The Story of Hoping Island de Chia-Wei Hsu évoque, plus qu’elle ne raconte, l’histoire d’une petite île qui occupe une place stratégique face aux chantiers navals sur les côtes taïwanaises. En fait on pourrait considérer ce petit épisode comme une métaphore de l’histoire de Taïwan, qui a été régulièrement envahie par les pays qui l’entourent. Avec comme seule image de fond des plans fixes de chantiers navals et une musique électronique parfois stridente, l’artiste donne à entendre les souvenirs passés que sa grand-mère aurait gardés de ces lieux.
Chia-Wei Hsu, The Story of Hoping Island, 2008 Vidéo, couleur, son, 12’40’’ Courtesy Centre culturel de Taïwan à Paris © Chia-Wei Hsu
KS Peut-on dire que certains artistes cherchent volontairement à brouiller les frontières entre art et anthropologie ? Certains font en effet le choix de présenter des entretiens filmés.
MP En effet des artistes comme Florence Lazar, Sally Gutiérrez, Noëlle Pujol et Andreas Bolm présentent des entretiens filmés mais la méthodologie, les codes et les objectifs sont bien différents de l’usage que les sciences sociales font de l’entretien. Anthropologues, historiens et journalistes s’emparent de l’entretien selon un protocole précis, en utilisant les informations issues des enquêtes et des témoignages comme document d’étude. A ce propos, nous avons organisé le colloque « Puissance de la parole » en mai dernier au Jeu de Paume, où un groupe d’artistes et de sociologues ont discuté de l’usage artistique de la parole et de ses différences par rapport à l’utilisation de l’entretien en Sociologie. L’enjeu pour les vidéoartistes est de développer une recherche esthétique dans leurs créations. Les images qu’ils produisent pour aborder leur sujet, sont sous-tendues d’une stratégie artistique.
Bien évidemment, il existe des contaminations entre les disciplines et les artistes puisent souvent leurs sources dans différents univers. Dans Le Lieu de la langue, le gitan avec lequel Florence Lazar s’entretient, procède à une description de son identité, qui apparaît de plus en plus confuse à mesure qu’il progresse dans son discours. L’un des objectifs de la pièce est probablement d’exprimer l’indéfinissable par la parole; son esthétique s’approche de celle d’un entretien fait par un anthropologue. Le groupe d’enfants qui parlent de leur camarade disparu dans Tous les enfants sauf un de Noëlle Pujol et Andreas Bolm, évoquent sa présence et essayent d’échapper à cette perte en la reliant à des évènements collatéraux. Mais dans ce deuxième cas, la pièce inclut également d’autres formes narratives et pas seulement l’entretien.
KS Paradoxalement, le réel que certains artistes donnent à voir est tellement marginal qu’il en paraît presque irréel.
MP Ils proposent en effet au spectateur de regarder par le trou de la serrure et de découvrir des réalités peu représentées dans les médias, qui ne s’en préoccupent seulement que lorsqu’un fait divers les rend apparentes. La vidéo Y’a plus d’os de Jean-Charles Hue nous fait complètement plonger dans l’univers des gens du voyage, pendant une soirée de conflits qui s’achève mal. Les premières images du film (les lieux, les acteurs et le contexte) sont prémonitoires d’une fin tragique. La situation présentée, sous une forme très construite, relève du domaine du privé. Cette mise en scène et cet aspect prévisible du récit rendent ce morceau de réalité irréel. D’autre part Lars Laumann présente Eija-Riitta Eklof, un personnage singulier dans sa vidéo Berlinenmuren. Le récit de cette dame qui est « objectophile » et mariée au mur de Berlin, est trop hors du commun pour paraître vrai. Cette histoire éveille notre « voyeur intérieur », le même qui nous conduit à regarder certaines émissions de télé-réalité où les témoignages recouvrent des histoires trop insolites pour être crédibles.
Lars Laumann, Berlinmuren, 2008 Vidéo, couleur, son, 24’17’’ Courtesy Maureen Paley, Londres (MP-LAUML-00011) © Lars Laumann
La question de la crédibilité apparaît aussi dans Comme Diana : la conspiration de la rose de Martin Sastre. Sous un style qui combine les clichés de la télévision et de la science fiction, cette vidéo raconte au présent la vie heureuse de Lady Diana de Galles dans un quartier périphérique de Montevideo. Dans ce cas là, ce n’est pas la marginalité qui rend l’histoire incroyable, mais l’exagération qui met en exergue notre sentiment de nous sentir trompés par les médias. À l’inverse, Rosa Barba, dans Outwardly from Earth’s Center, propose une situation fictive qui se présente comme un documentaire réalisé avec de vrais entretiens. Dans ce cas là, les stratégies propres au format documentaire sont utilisées pour nous faire croire en l’authenticité de la narration qui ne l’est qu’à moitié.
Rosa Barba, Outwardly from Earth’s Centre, 2007 Vidéo, couleur, son, 22’18’’ Courtesy de l’artiste, Giò Marconi, Milan et carlier / gebauer, Berlin © Rosa Barba
KS La plupart des œuvres que tu as sélectionnées utilisent en effet des codes de l’esthétique documentaire, afin de produire un effet d’objectivité et de véracité. Une construction du réel demeure pourtant dans les procédures de cadrage ou le choix de la mise en scène qui vise à mettre en valeur ce réel marginal.
MP Les stratégies documentaires sont probablement les plus fréquemment utilisées pour traiter des sujets liés à l’histoire ou à la réalité sociale. Il y a donc des artistes qui utilisent ces codes là, mais il existe aussi une diversité de déclinaisons.
Le Taïwanais Ming-Yu Lee combine des images d’origines diverses (d‘anciens enregistrements en super 8 ou des extraits filmés depuis son portable), pour nous parler de l’absence de son père et faire un lien entre le passé et le présent. On retrouve aussi cette esthétique du document dans les pièces de Jean-Charles Hue, Florence Lazar, Noëlle Pujol et Andreas Bolm. L’intérêt des artistes pour ce format là se produit parallèlement à l’incorporation des phénomènes politiques et sociaux dans leurs recherches artistiques. Mais comme je l’ai déjà mentionné, « les documentaires artistiques » ne donnent pas une représentation simple et transparente des évènements comme celle que proposent les formats journalistiques.
KS Cette esthétique du documentaire est aussi utilisée pour faire des portraits de lieu…
MP Oui, mais toujours depuis des optiques diverses.
Jeremy Deller donne la parole aux gens, à la musique et au paysage pour dépeindre l’état du Texas aux Etats-Unis. Les dernières minutes donnent à voir le vol de milliers de chauve-souris, une image absolument courante pour les Texans mais qui vue d’ailleurs prend une dimension fantastique. Dans Chisinau, Ville difficile à prononcer, Pavel Braila développe une autre approche en laissant les lieux parler d’eux-mêmes, par un dispositif de triple écran qui nous montre l’évolution d’une journée dans cette ville. L’artiste explique qu’il a souhaité faire un portrait de sa ville, pour faire un registre et produire de l’archive. Depuis la proclamation d’indépendance de la République de la Moldavie, en 1991, aucun document graphique, aucune image n’a en effet été produite sur sa capital — à l’exception de celles réalisées par les télévisions. Les écoles abandonnées des zones rurales présentées dans Espace de mémoire 1 de Shang-Lin Wu témoignent, quant à elles, de la migration forcée de la population coréenne vers les villes. Ces architectures désertées évoquent un passé qui est encore proche et donne à voir une nature qui reprend sa place, inexorablement.
Pavel Braila, Chisinau – City Difficult to Pronounce, 2010 Vidéo, couleur, sonore, 18’9’’ Courtesy de l’artiste © Pavel Braila
KS Le but est-il de produire une ambiguïté et une confusion entre le vrai et le faux, afin de faire naître une autre lecture de la réalité sur un mode légendaire, mémoriel et nostalgique?
MP C’est le cas dans certaines pièces, comme celles de Lars Laumann ou de Rosa Barba, où l’ambigüité est l’un des sujets centraux. Dans Acts, Anna Gaskell envisage le rapport au passé sous un autre angle. Les images d’une Amérique légendaire sont accompagnées d’une voix off au ton monocorde, qui raconte le passé d’une jeune fille. Un va et vient entre passé et présent et entre intime et public a lieu sous le cadre irréel d’images presque trop belles, mais néanmoins dramatiques. Une certaine nostalgie émane de ce film, comme de celui de Daniel Lê qui met en scène l’oncle de l’artiste se remémorant les célébrations de la fin de la 2ème Guerre mondiale, avec une performance de la chanson God Save the King. Dans cette pièce, des fragments du passé filmé par son oncle en super 8 à Londres se mêlent au présent.
KS Certains artistes usent d’autres stratégies pour produire ces récits alternatifs, comme l’humour.
MP S’emparer de l’humour pour présenter des réalités dures est une possibilité utilisée par les artistes, pour créer une distance critique avec la réalité.
Teresa Serrano récupère l’esthétique des télénovelas, donc un langage très basique et accessible, pour parler de l’abus du pouvoir et du harcèlement dans des contextes quotidiens. L’axe est un boléro d’Armando Manzanero dans lequel un macho répète à sa femme bien aimée qu’elle lui appartiendra toujours. Ce décalage entre la chanson d’amour et les images nous fait sourire face à une réalité qui, en l’occurrence, n’est pas drôle du tout. Patricia Esquivias se moque des grands discours de l’histoire, en créant des rapports fantaisistes entre des personnages et des récits. Elle utilise, pour ce faire, des récits populaires, des histoires vernaculaires qui circulent sans vérification, et que nous appelons aussi « les légendes urbaines ». On aime bien croire ce qu’on nous raconte, on se laisse séduire par des histoires extravagantes qui nous amusent. La conférence-performance d’Esquivias mélange des anecdotes avec des faits historiques pour nous distraire, et en même temps pointer l’actuelle culture de l’ « entertainment ». La pièce de Martin Sastre dont j’ai déjà parlé, critique cette même vacuité culturelle.
Patricia Esquivias, Folklore # 2, 2007 Vidéo, couleur, son, 13’52’’ Courtesy galerie Murray Guy, New York © Patricia Esquivias
KS Ces artistes cherchent tous à rendre apparentes des réalités qui sont absentes du discours dominant (qu’il s’agisse des manuels d’histoire ou des médias d’information). Considères-tu cette approche comme un art critique ou politique?
MP En tant que pièces qui portent sur les fonctionnements de notre société, la réponse est oui : on peut affirmer que ces vidéos sont politiques. Je pense que tout art ancré dans le réel est politique car il parle des relations humaines. Les récits que déploient les vidéos sélectionnées traitent de nos différences et de nos ressemblances, des rapports de pouvoir, des préjugés à travers lesquels nous regardons le monde, de la manipulation des informations… Ils nous donnent à penser sur nous-mêmes.
Giovanna Zapperi définit la pratique de Florence Lazar comme une approche micropolitique du savoir [1]. En effet ses vidéos, comme d’autres qui sont présentées dans la Vidéothèque éphémère, donnent au spectateur la possibilité de comprendre et de chercher une position qui ne soit pas prédéterminée. Elles ouvrent des brèches sur des événements complexes et traumatiques à travers des stratégies narratives différentes.
Comme tu le dis, les réalités présentées par ces artistes sont souvent absentes des médias mais c’est peut être le rôle des institutions culturelles contemporaines de les faire entrer dans l’espace public, de rapprocher le public d’un type d’images et de problématiques, moins pour chercher à le convaincre de leur véracité, que pour créer un espace où la prise de parole soit possible.
J’aimerais finir avec une réflexion du philosophe Boris Groys, qui dit que l’une des différences entre les arts visuels, notamment la vidéo, et les images véhiculées par les médias, est que ces derniers cherchent à produire des images iconiques à partir de l’actualité, comme le faisait l’art classique : des images persuasives, proches des chefs-d’œuvre, singulières et puissantes. Le rôle de l’art contemporain, est de mettre une distance entre le présent et le passé, en créant des discours critiques qui enrichissent la vision proposée par les mass médias. Je cite : « chaque discours a besoin d’une comparaison – une technique de valorisation et de dévalorisation symbolique qui peut seulement s’appliquer aux phénomènes de la culture d’aujourd’hui. Compte tenu du climat culturel ambiant, les institutions artistiques constituent de manière pratique les seuls lieux où nous pouvons réellement nous distancier de notre propre présent et le comparer avec d’autres ères historiques… Le contexte artistique est presque irremplaçable, parce qu’il est particulièrement bien adapté à l’analyse et au défi critique des revendications du Zeitgeist, telles que véhiculées par les médias »[2]
Je pense que « Faux Amis / une vidéothèque éphémère » s’inscrit dans cette vocation de mettre en évidence la vision critique de la réalité à travers les interprétations nécessaires des artistes contemporains.
[1] Giovanna Zapperi, « Micropolitiques de la visibilité : Florence Lazar », Revue Rue Descartes, n° 67, Paris, PUF, 2010.
[2] «every such discourse needs a comparision, – a technique of simbolic valorization and devalorization that can only be applied to the phenomena of today’s culture. Given to our current cultural climate, the arts institutions are practically the only places where we can actually step back from our own présent and compare it with other historical eras. …. The arts context is almost irremplaceable because it is particulary well suited for criticaly analyzing and challenging the claims of the media-driven zeitgeist ». Boris Groys : « The Fate of Art in the Age of terror » dans Making Things Public : Atmospheres of Democracy, Bruno Latour et Peter Weibel, eds., (Cambridge, Mass : MIT Press, 2005).
Visuel en page d’accueil : Annika Ström, Ten New Love Songs, 1999; vidéo, couleur, son, 22’18’’. Courtesy FNAC 01-252, Centre national des arts plastiques – ministère de la Culture et de la Communication, Paris © Annika Ström