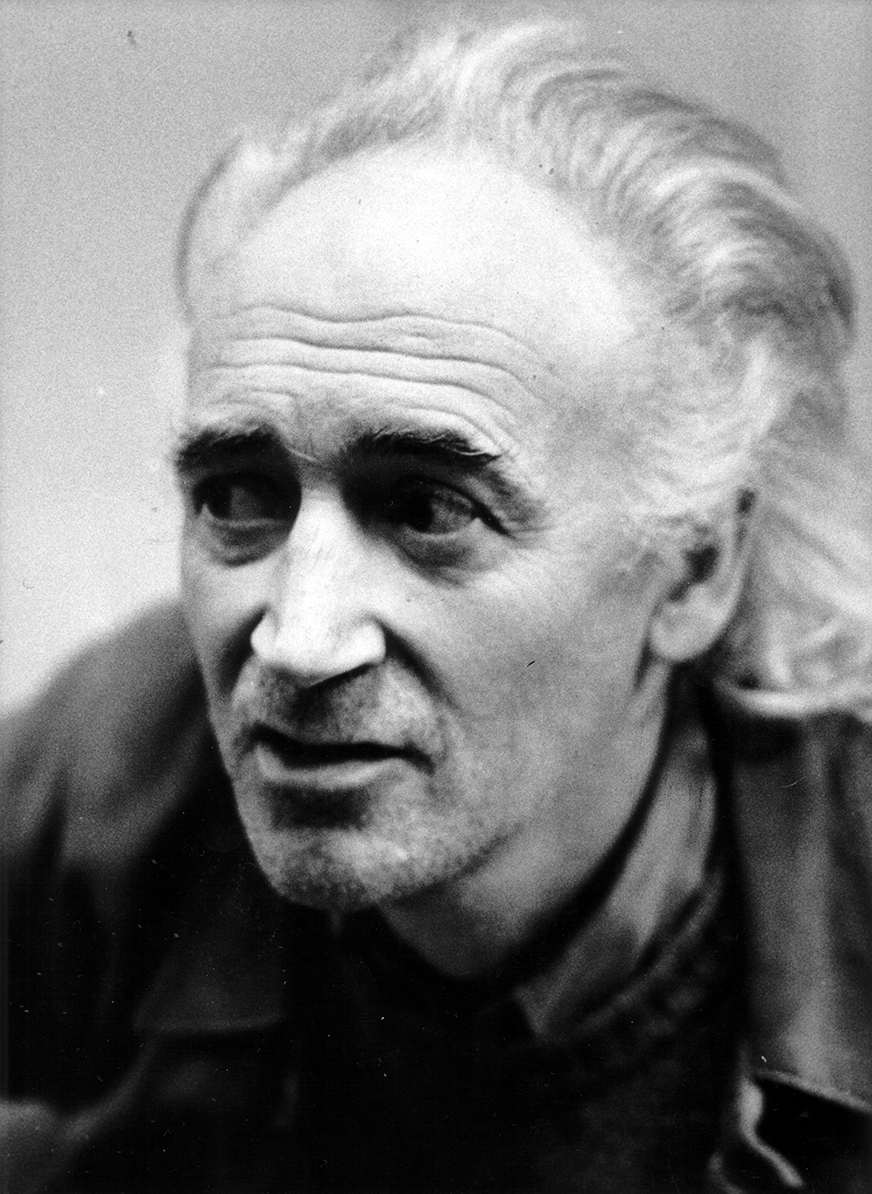« Prends garde, censeur, regarde cette main de femme palpiter au premier plan, regarde cet œil ténébreux, regarde cette bouche sensuelle, ton fils en rêvera cette nuit et, grâce à eux, il échappera à la vie d’esclave à laquelle tu le destinais. [… Les censeurs] ne reconnaissent pas la toute-puissante vertu libératrice du rêve, de la poésie et de cette flamme qui veille dans tout cœur assez fier pour ne pas se comparer à une porcherie. Malgré leurs ciseaux, l’amour triomphera. Car le cinéma n’est un instrument de propagande que pour les idées hautes. »*
La sensuelle mise en garde de Robert Desnos, publiée en 1927, décrit comment, dans toutes les sphères de l’existence, publique, collective, privée, intime, fantasmatique, il existe des conventions, des interdits et des tabous. L’histoire de la censure institutionnelle et celle des arts s’entrelacent comme deux plantes volubiles autour du cep social.
Bras judiciaire de ce qu’une société refoule comme dangereux pour sa survie, la Censure d’État se trompe rarement. Au mitan du XXe siècle, elle a donc, par exemple, judicieusement tenté de désamorcer trois des films les plus explosifs et programmatiques pour le devenir des formes : Afrique 50, pamphlet anticolonialiste de René Vautier (1950), Un Chant d’amour, poème visuel érotique de Jean Genet (1950), et L’Anticoncept, installation cinétique et sonore de Gil J Wolman (1951). Les deux premiers sont tournés clandestinement et interdits, le troisième censuré « pour imbécillité ». Afrique 50 vaudra un an et un jour d’inculpation à René Vautier. L’intrépidité et l’inventivité des auteurs (de respectivement 22, 30 et 21 ans) ont offert au cinéma trois bombes formelles, toutes trois indissociablement politiques, érotiques et plastiques, et l’on pourrait résumer l’histoire esthétique du XXe siècle en analysant les différences manifestes et les similitudes plus profondes qui traversent cette sublime triade involontaire. Souvent, René Vautier et Armand Gatti rivalisaient à qui des deux avait le plus subi l’honneur violent de la censure, et tous deux ont gagné : René Vautier parce qu’il compte à son actif le plus de films interdits, Armand Gatti parce qu’il a été interdit dans plus de pays. À ses hauts faits politiques, s’ajoute l’allégorie souvent racontée par René. En 1973, à l’issue de ses 31 jours de grève de la faim afin d’obtenir un visa d’exploitation pour Octobre à Paris de Jacques Panijel (1962, tourné clandestinement pour documenter le massacre commis contre des manifestants algériens par la police française aux ordres du préfet Papon), le film reçoit un visa. De fait, il le reçoit dès le neuvième jour, mais il en fallait plus à René Vautier, exigeant aussi que la censure désormais justifie ses arrêts. « Le 27 janvier 1973, au 27ème jour de la grève »**, à l’hôpital de Quimper où il se trouve alité, René reçoit la visite d’un mystérieux fonctionnaire qui s’assoit au pied de son lit et lui explique posément que sa victoire s’inscrit dans un échec plus vaste : la censure politique ne pèse rien au regard de la censure économique.
Aujourd’hui, en ce temps de graves régressions politiques, culturelles, cultuelles, pèsent toujours plus lourdement sur les artistes au moins quatre sortes de censure : la censure politique, objet d’une législation ; la censure économique, informelle ; la censure de la société civile, qui ne cesse de monter en puissance ; et l’autocensure, qui allie consignes sociales et mutilations psychiques. Autant que des formes, des contenus, des élaborations de toutes sortes, les œuvres deviennent des syndromes : non plus seulement au sens où elles se confrontent aux limites et apories de leur temps, à l’instar des Fleurs du Mal poursuivi pour « outrage à la morale publique » ; mais en tant que champ d’exercice de la volonté de puissance d’autrui, otages de plus en plus fréquent dans des démonstrations de force cherchant à tester et révéler la faiblesse, l’aboulie voire la nullité des structures collectives : une galerie, un musée, un État, une société supposée défendre la liberté d’expression. C’est pourquoi nous avons consulté huit artistes parmi les plus courageux de ce temps, qui ont fait leurs preuves face à l’oppression, la répression et la censure, dans plusieurs pays et dans des situations politiques différentes. Nous nous sommes entretenus respectivement avec (par ordre alphabétique) :
Ing Kanjanavanit, dite Ing K, cinéaste (Thaïlande)
Bani Khoshnoudi, plasticienne, cinéaste (Iran)
Jocelyne Saab, cinéaste, plasticienne (Liban)
Tan Pin Pin, cinéaste (Singapour)
Leur pertinence politique, leur bravoure, parfois leur ingéniosité à défier la censure, à monter à l’assaut au lieu de jouer en défense ou passer sous les fourches caudines, offrent autant d’exemples analeptiques, salubres, voire jubilatoires. On aura donc compris que ce blog se consacre principalement à explorer les puissances offensives des images.
« Si les films étaient incapables de susciter le moindre changement, pourquoi seraient-il si nombreux à se voir censurés dans tant de pays ? Pourquoi tant d’efforts concertés pour bloquer Le Sel de la terre à chaque stade de sa fabrication ? Pourquoi faire ‘disparaître’ Raymundo Gleyzer ? Pourquoi maintenir Jafar Panahi en résidence surveillée ? Pourquoi Dhondup Wangchen, cinéaste tibétain, serait-il emprisonné et torturé ? », écrivait le grand cinéaste et activiste John Gianvito***.
Nicole Brenez
* Robert Desnos, Le Soir, 19 mars 1927, cité par Jean-Luc Douin, Dictionnaire de la censure au cinéma, Paris, PUF, 1998, p. 124.
** René Vautier, « Ma peau dans la balance », Caméra citoyenne, Rennes, éditions Apogée, 1988, p. 5.
*** « John Gianvito, la contemplation productive », Cahiers du Cinéma n°676, mars 2012, p. 81.
Crédits
Traduction en anglais : Brad Stevens / Coproduction : Institut Universitaire de France